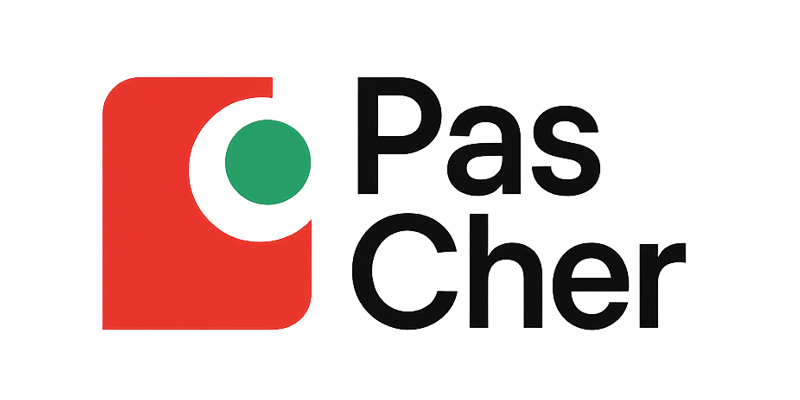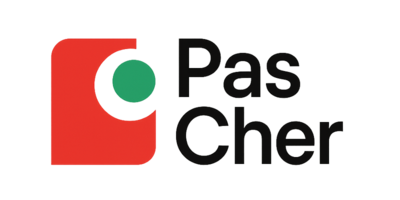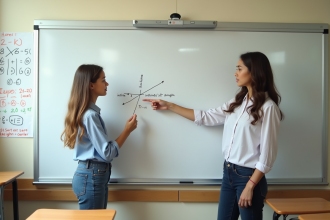Un brevet déposé à la fin des années 1990 décrit une structure agricole empilée, pensée pour maximiser la production alimentaire en milieu urbain. Ce concept, longtemps ignoré par l’industrie, s’est progressivement imposé dans les agendas de la recherche appliquée, en réponse à la pression démographique et à la raréfaction des terres arables.
L’auteur de cette innovation, professeur d’université, a d’abord rencontré un scepticisme marqué dans le monde académique et institutionnel, avant de voir ses travaux cités par des acteurs majeurs de l’agriculture et de l’urbanisme. L’histoire de cette invention révèle les tensions entre vision prospective et contraintes de l’acceptabilité sociale.
La ferme verticale, une réponse innovante aux défis de l’agriculture urbaine
L’agriculture verticale s’impose peu à peu dans le débat public, au croisement des nécessités alimentaires et de la rareté de l’espace en ville. Empiler les cultures sur plusieurs étages, à l’abri des aléas climatiques, c’est bousculer l’ordre établi du champ à perte de vue. Les méthodes comme l’hydroponie, l’aéroponie ou l’aquaponie permettent de cultiver sans terre, tout en économisant jusqu’à 95 % d’eau par rapport aux techniques classiques. Résultat : des légumes et fruits produits localement, en toute saison, avec une logistique repensée et une réduction marquée de l’empreinte carbone.
Quelques exemples témoignent de cette évolution : à Paris, la ferme souterraine La Caverne fait pousser champignons et endives sous un parking, tandis qu’à Château-Thierry, Jungle fournit herbes aromatiques et plantes pour le marché de Rungis ou les parfumeurs de Grasse. Les fraises d’Agricool, les framboises de Rootlabs élargissent le spectre, même si la rentabilité reste, pour l’instant, limitée à certains créneaux.
Voici les principaux défis que ces pionniers cherchent à relever :
- optimiser chaque mètre carré en ville,
- réduire la pression sur les ressources naturelles,
- garantir une alimentation fiable dans des environnements densément peuplés.
Mais la technologie a un revers : la note énergétique, parfois salée, et la dépendance à des produits chimiques pour certaines cultures. Si les fermes verticales à Singapour, au Japon ou aux États-Unis montrent la faisabilité technique, l’Europe tâtonne encore. Dans ce secteur, ingénieurs, phytobiologistes, data scientists se mobilisent pour faire émerger une agriculture urbaine à la fois résiliente et pérenne.
Qui a imaginé la ferme verticale ? Portrait d’un pionnier et genèse d’un concept
Le concept de ferme verticale tel qu’on le connaît n’a rien d’un simple fantasme de science-fiction. Il s’enracine dans la réflexion d’un chercheur américain : Dickson Despommier. Professeur à l’Université Columbia, il imagine dès 1999 une nouvelle manière de nourrir les villes, affranchie des saisons et du sol, en anticipant les projections démographiques de l’ONU. C’est lors d’un séminaire qu’il engage ses étudiants à réfléchir à la raréfaction des terres agricoles et à la sécurité alimentaire, posant les bases d’un nouveau modèle.
Sa proposition est limpide : installer la production alimentaire au cœur des métropoles, sur plusieurs étages, en limitant l’impact sur l’environnement. Despommier montre qu’un immeuble de 30 étages pourrait alimenter jusqu’à 50 000 personnes grâce à l’hydroponie et l’aéroponie. Rapidement, médias, urbanistes, investisseurs s’emparent de l’idée. La ferme verticale tranche avec la monoculture à grande échelle et invite à repenser la proximité des circuits alimentaires.
Depuis, Despommier reste une référence pour l’ONU et inspire de nombreuses villes cherchant à limiter l’étalement urbain. En France, la chercheuse Christine Aubry adapte le concept au contexte local et expérimente sur le terrain. Le modèle n’a rien de figé : il s’enrichit de nouvelles technologies, de nouveaux acteurs, mais conserve cette ambition d’inventer une autre façon de produire en ville.
Entre progrès technologique et acceptabilité sociale : quelles perspectives pour l’agriculture verticale ?
La singularité de l’agriculture verticale, c’est l’intégration de technologies avancées. À Bristol, LettUs Grow combine aéroponie et pilotage informatique (Ostara), ajustant en temps réel l’humidité ou la lumière. À Londres, Square Mile Farms installe des fermes hydroponiques sur les toits d’immeubles de bureaux, menées par Dhiresh Tailor. En France, Vertical Future travaille sur des solutions mêlant capteurs IoT et gestion automatisée, avec le concours de phytobiologistes et d’ingénieurs. Ce secteur attire aujourd’hui des profils venus aussi bien de l’informatique que de la biologie ou de la data.
Mais innover ne suffit pas : la dimension sociale pèse lourd dans l’équation. Margaux Tiberghien (PwC) et Marie Fiers (association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle) insistent sur la nécessité de transparence, de traçabilité et de dialogue avec les citoyens. Les fermes verticales n’ont pas vocation à remplacer les modèles agricoles classiques ; elles complètent l’offre, en ciblant des productions de niche comme les fraises, les herbes fines ou les plantes pour la cosmétique.
Certains obstacles persistent. Le modèle reste tributaire d’une consommation énergétique élevée, et les marges sont encore limitées à quelques cultures. Pourtant, les bénéfices sont tangibles : économie d’eau, optimisation du foncier, production locale, moindre pression sur les écosystèmes. Reste à consolider l’intégration sociale et urbaine : comment impliquer les habitants, garantir l’accès à ces nouveaux espaces, inventer d’autres usages pour la ville ? À mesure que les tours agricoles s’élèvent, la ville réapprend à cultiver, questionne ses priorités et esquisse une autre relation au vivant.